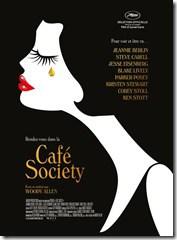 Après une comédie légère et assez anecdotique (Magic in the moonlight) et une fable dostoïevskienne que d’aucuns qualifieraient de “mineure” (L’Homme irrationnel), Woody Allen revient en grande forme avec Café Society, un film quasi-parfait, oscillant entre comédie et drame, légèreté et gravité, acidité et amertume. Comme les grands auteurs littéraires, il observe avec beaucoup d’acuité la “comédie humaine”, les élans du coeur et les tourments de l’âme. Il recycle également avec finesse quelques-uns des éléments-clés de son oeuvre (la famille, le Judaïsme, l’opposition entre New York et Hollywood, le cinéma…) et rend hommage à quelques auteurs et acteurs qui l’ont inspiré.
Après une comédie légère et assez anecdotique (Magic in the moonlight) et une fable dostoïevskienne que d’aucuns qualifieraient de “mineure” (L’Homme irrationnel), Woody Allen revient en grande forme avec Café Society, un film quasi-parfait, oscillant entre comédie et drame, légèreté et gravité, acidité et amertume. Comme les grands auteurs littéraires, il observe avec beaucoup d’acuité la “comédie humaine”, les élans du coeur et les tourments de l’âme. Il recycle également avec finesse quelques-uns des éléments-clés de son oeuvre (la famille, le Judaïsme, l’opposition entre New York et Hollywood, le cinéma…) et rend hommage à quelques auteurs et acteurs qui l’ont inspiré.
Le récit débute dans les années 1930. Bobby Dorfman (Jesse Eisenberg), jeune Juif newyorkais fasciné par le milieu du cinéma, débarque à Los Angeles avec pour idée d’y réussir sa vie professionnelle, s’offrir une de ces villas que les stars possèdent à Beverly Hills et accessoirement trouver l’âme soeur.
Son oncle Phil (Steve Carell), célèbre agent de stars, accepte de le prendre sous son aile, mais, n’ayant que peu de temps à lui consacrer, il charge sa secrétaire, la ravissante Vonnie (Kristen Stewart) de l’aider à s’acclimater et de lui faire découvrir la ville. Après quelques heures passées en compagnie de la jeune femme, il en tombe profondément amoureux. Hélas pour lui, si Vonnie ne semble pas insensible à son charme, elle n’est pas libre…
Pourtant, un soir, la jeune femme débarque chez lui pour lui annoncer qu’elle vient d’être larguée par son petit ami, un homme marié qui n’arrive pas à quitter à sa femme pour elle. Bobby entrevoit alors un futur radieux, un mariage heureux et un retour triomphal à New York…
A ce moment, on se dit que le scénario va ressembler à une de ces comédies musicales de l’époque, qui mettaient en scène Fred Astaire et Ginger Rogers – dont Phil est l’agent -, que l’amour va triompher des embûches qui se dressent sur le chemin de nos deux tourtereaux et que tout se finira dans un happy end comme seul le cinéma hollywoodien sait en trousser. Mais Woody Allen n’est pas un cinéaste hollywoodien et la vraie vie n’est pas une comédie romantique… Comme il l’affirme dans une réplique pleine de malice : “La vie est une comédie écrite par un auteur sadique”.
Les relations humaines sont complexes, les sentiments sont tumultueux. Certaines amours sont impossibles, d’autres génèrent de la frustration, de l’insatisfaction. Tous les couples du film éprouvent, d’une manière ou d’une autre, cette sensation d’inachevé et rêvent de vies sentimentales plus exaltantes. La mère de Bobby passe son temps à dénigrer les facultés intellectuelles de son mari, sa paresse, ses nombreux défauts. Son père, du coup, se demande pourquoi il reste avec elle. Sans doute parce que ces deux-là s’adorent, même s’ils passent leur temps à se chamailler, comme un vieux couple. La soeur de Bobby aime aussi son intellectuel de mari, mais ne manque pas de le critiquer quand il tente, en vain, de résoudre les conflits de voisinage par le dialogue et la diplomatie. Phil, de son côté, se retrouve partagé entre son épouse, qu’il a aimée et chérie pendant vingt-cinq ans, et sa maîtresse, pour qui il ressent des sentiments encore plus intenses.

Tous les personnages fantasment sur une autre personne, une autre vie, un ailleurs idéal. Sur la côte est, on rêve de Californie, de stars et de cinéma. Sur la côte ouest, on rêve des soirées newyorkaises, de l’effervescence de Greenwich Village, de boîtes de jazz… Mais les deux lieux sont-ils si différents? Au début du film, Bobby le pense et le chef-opérateur, Vittorio Storaro, s’attache à filmer différemment Los Angeles et New York, donnant à l’une des couleurs chaudes, solaires, et à l’autre des couleurs plus froides, une lumière désaturée. Puis peu à peu, les différences visuelles s’estompent à mesure que le jeune homme réalise qu’il ne peut être parfaitement heureux ni dans une ville, ni dans l’autre.
Bobby cherche à d’abord à quitter New York pour fuir sa famille et s’épanouir sous le soleil de Californie, mais il réalise rapidement que ce monde de glamour et de paillettes est trop superficiel pour lui. Puis il retourne dans la Grande Pomme pour finalement travailler avec son frère, dans le night-club de ce-dernier, et retrouver le même genre de milieu mondain et bourgeois qui l’ennuyait dans la “cité des anges”, où se côtoient artistes, intellectuels et hommes d’affaires. Il s’imposera dans cet environnement et y trouvera la reconnaissance souhaitée. Pour autant, il ne sera jamais totalement satisfait et repensera avec nostalgie à sa vie d’avant, à Los Angeles.
Pour Woody Allen, l’être humain est un éternel insatisfait. Il ne peut se contenter de ce qu’il est ou de ce qu’il a. Il lui faut toujours plus, toujours mieux. Certains arrivent à vivre avec ce sentiment et à être heureux malgré tout. D’autres ont plus de difficulté à l’accepter et font des choix supposés leur permettre de trouver le bonheur – ou l’illusion du bonheur.

Cette notion de choix est au coeur du récit. Tous les protagonistes choisissent leur destin, leur voie professionnelle. Quand la soeur de Bobby décide de devenir enseignante, pour être utile à la société, son frère aîné choisit de devenir gangster et de réussir en écrasant les autres. Vonnie, de son côté, est partagée entre deux options de vie radicalement opposées. Une vie simple, loin des fastes hollywoodiennes, où elle pourrait être elle-même, et une vie faite de luxe et de paillettes, lui permettant de réaliser son rêve d’actrice en jouant le rôle d’une épouse bourgeoise-modèle. Bobby lui-même est amené à prendre des décisions cruciales pour son avenir. Chaque choix a des conséquences, heureuses ou malheureuses, et les personnages doivent les assumer, avec leur cortège de regrets, de remords, de tourments existentiels.
Au-delà de la question du choix, il y a aussi l’idée des ravages du temps. Au fil des années, les personnages évoluent. Leurs certitudes s’estompent. Leurs idéaux changent. En bien ou en mal.
Pour le frère de Bobby, c’est un changement plutôt positif. Il cherche à abandonner le crime pour un métier plus décent et devient propriétaire d’un night club, même si, pour que tout fonctionne bien, il a parfois recours à des méthodes de négociations assez extrêmes. Plus tard, il cherchera la rédemption en se convertissant au catholicisme – choix qui lui garantit également la vie après la mort, contrairement à sa religion d’origine…
Pour Bobby et Vonnie, l’évolution est plus douloureuse. Quelque années après leur rencontre, ils réalisent que leur candeur juvénile s’est peu à peu estompée pour laisser place à plus de pragmatisme et la raison a fini par l’emporter sur les sentiments, qui doivent désormais rester confinés au plus profond des âmes et ne plus transparaître qu’à travers les regards perdus des protagonistes. La séquence finale, sublime, qui a lieu lors d’un réveillon du nouvel an, marque justement la fuite du temps et sonne le glas de leurs amours impossibles.

Derrière son apparence de comédie légère, portée par les dialogues ciselés, pleins d’humour et d’esprit de Woody Allen, les mélodies jazzy, les plans-séquences virtuoses, Café Society est un film très profond, teinté d’amertume et de désenchantement.
Certains esprits chagrin trouveront probablement qu’une fois de plus, le cinéaste newyorkais ne se renouvelle pas vraiment. Mais en même temps, les comportements humain qu’il dépeint n’ont pas vraiment changé non plus. Si l’intrigue se déroule dans les années 1930 et dans un milieu plutôt bourgeois, elle aurait tout aussi bien pu se dérouler de nos jours et dans un milieu plus populaire. Le sujet est intemporel et universel. Il touchera probablement tous ceux qui ont connu des tourments sentimentaux et des déceptions amoureuses, ou tout ceux qui ont l’âme romantique.
Et quelle virtuosité technique! Chaque plan est une petite merveille de mise en scène, avec des cadrages parfaits, des mouvements de caméra sublimes qui ont le bon goût de rester discrets, des jeux de lumière subtils… Tout est beau, élégant, d’une précision extrême.
Café Society est le film d’un cinéaste mature, expert en sentiments humains et maître de son art. C’est un long-métrage abouti qui s’inscrit parmi les plus belles réussites de Woody Allen.
N’ayons pas peur des mots : c’est un chef d’oeuvre.
